Articles récents dans Toutes catégories
Fêtons le Roi 2026 !
15 janvier 2026 – Galette et nouveau roi des Carnavalières et...
Le temps de la galette des Rois
Jamais janvier sans galette…Les modes passent mais pas celle de...
Moins de cent jours avant le 107e carnaval de Cholet
Mi-janvier – Comme un parfum de carnavalAu temps des galettes, à...
System’D – Un repas chaleureux
Pause convivialeEn cette fin d’année 2025, les carnavalières et...
Carnaval de Cholet – la Construction fin 2025
À la découverte des chars fin 2025System’DColonnes,...
Noël miniature 2025
Miniatures en Fête !Joyeuses fêtes de fin d’année 2025 en...
Travail de Romains
System’D – 14 novembre 2025Jamais, jusqu’à ce jour,...
Premières soudures pour le char 2026
Ça y est, c’est vraiment parti pour 2026!Premiers coups de scie,...
Assemblée générale 2025
Du bilan 2025 aux projets 2026System’D a réuni ses troupes le...
System’D – La maquette pour le 107e carnaval
« À faire des tas ! » – Un char aux 2 visagesComme le dieu...



















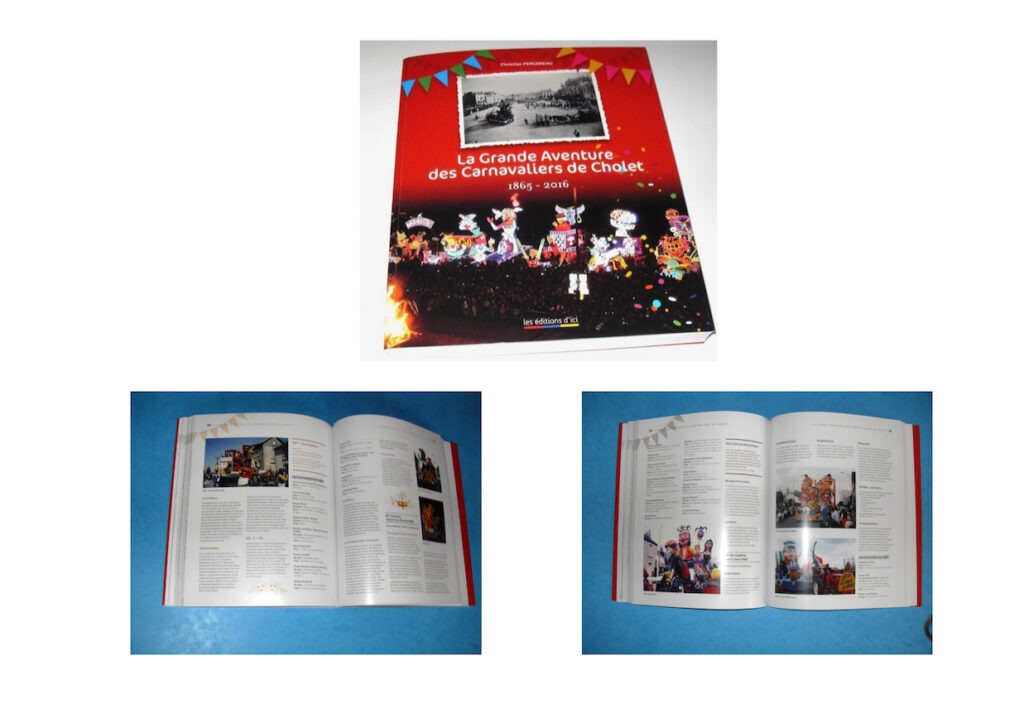
Commentaires récents